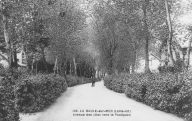Désignation
Dénomination : lotissement
Précision sur la dénomination : lotissement concerté
Appellation et titre : lotissement Benoit
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : hôtel de voyageurs ; villa ; jardin ; rue ; allée ; promenade ; jardin public ; tennis
Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 44055
Aire : Côte-d'Amour (La)
Canton : Baule-Escoublac (La)
Milieu d'implantation : en ville
Historique
Commentaire historique : Depuis que son père, Joseph Antoine, s'était installé en 1926 avec le maire de Nantes Louis Levesque sur le tombolo d'Escoublac le long de l'étier du Pouliguen pour construire une raffinerie de sel, Jules Benoit ne vivait que pour ce sel. Son père et son associé nantais avaient acheté au comte de Sesmaisons la concession des dunes d'entre l'étier et le chemin de Beslon (avenues des Hirondelles et du Maréchal Franchet d'Esperey) en 1834. Premier employeur de la commune du Pouliguen, Jules en devint le premier maire en 1854 défendant ardemment les paludiers et leurs marais salants. Vers 1860, il construit près de sa raffinerie une grande demeure "Ar Zonj" (le songe breton) pour y recevoir les villégiateurs de marque. En 1879, il se réjouit de l'ouverture de la ligne de chemin de fer que les paludiers réclamaient depuis 1860 pour livrer leur production salicole au plus vite à Paris. Déjà un ami industriel, Henri Huser, fait dresser au bord de la plage à l'entrée de l'étier une grande demeure "Ker Suser". Il lui est facile de prendre le train à Nantes et débarquer au Pouliguen pour ensuite traverser le pont sur l'étier et longer le quai jusqu'à sa "villa" construite sur la commune de la Baule.
Vers 1881, Georges Gralpois, entrepreneur au Pouliguen, qui a réalisé "Ker Suser", démontre au fils de Jules Benoit que l'exemple du comte Hennecart est très intéressant tant sur le plan financier que sur le plan paysager : en effet, si les Benoit vendent des parcelles de terrain sablonneux non seulement ils rentabilisent leur mise de fond acquise par le grand père Joseph Antoine mais en plus, ils fixent les dunes (objet de la concession) par la construction de villas et de jardins. Bref, il lui démontré les avantages d'un lotisseur. Jules Benoit fils décide donc de créer lui aussi son lotissement entre l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et la plage puisque les nantais apprécient ce site si calme. Tout comme Hennecart qui appela l'architecte Georges Lafont, il fait appel à un jeune architecte-paysagiste de Nantes, François Aubry. Celui-ci aurait travaillé avec Noisette que Louis Levesque fit venir pour les jardin nantais. Fort de cette expérience, il trace le lotissement Benoit en 1882 avec une grande avenue tangente à la mer qu'il nomme avenue des Lilas. Aubry positionne quelques villas aux entrées du lotissement et les publie dans un recueil en les situant non pas à la Baule mais au Pouliguen car le lotissement Benoit est desservi par la gare, la poste, les commerces, le médecin du Pouliguen. Une pétition est organisée pour scinder la "plage Benoit" de la commune d'Escoublac mais jamais le conseil municipal ne cédera à cette supplique. Les copropriétaires du lotissement vont même jusqu'à nommer leur plage "la Grande plage du Pouliguen ". En 1892, une association syndicale est créée rassemblant tous les copropriétaires. Première association locale bauloise, elle est toujours en vigueur alors que celles des autres lotissements crées par la suite ont toutes disparu.
En 1886, Alexandre Mauspha érige le deuxième grand hôtel de la plage d'Escoublac, construit en moellon de granite, brique et bois sculpté, (le premier hôtel toujours debout et agrandi est maintenant situé sur la commune de Pornichet). L'hôtel de Mauspha sera nommé vers 1900 "hôtel de la plage et du golf" car jusqu'à la grande guerre, il fut question d'établir le golf de la Baule au niveau de l'actuel stade Moreau Desfarges. François André qui fit construire le casino récupéra vers 1926 une partie des terrains du lotissement derrière l'avenue de Lattre de Tassigny pour y établir des tennis, un tir au pigeons et un centre équestre. Il créa le golf au Pouliguen (nommé Golf-club de la Baule). En 1924, Roger Bernheim racheta l'hôtel qu'il nomma par la suite "hôtel plage et golfe" (sic).
Le boulevard de mer de la Baule ne passe pas le long de la plage Benoit car, lors des premières constructions à la fin du 19e siècle, celles-ci ne respectèrent pas l'alignement des lais de mer (marée d'équinoxe). Les affaires maritimes eurent de nombreuses difficultés à faire respecter leur territoire. En 1824, le plan d'aménagement, d'extension et d'embellissement de la Baule prévoyait de continuer le boulevard de mer par un pont transbordeur au bout de l'esplanade pour rejoindre la plage du Pouliguen mais ce projet ne vit pas le jour car la place manquait pour le passage des voitures et la promenade des piétons. Cette esplanade est entretenue par l'association des copropriétaires et demeure une promenade végétale et fleurie très prisée. Le terrain derrière l'avenue du Maréchal de Lattre entre le stade et les tennis fut loti vers 1960.
Datation(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Date(s) : 1882
Justification de la datation : daté par source ; daté par travaux historiques
Auteur(s) : Aubry François (architecte)
Justification de l'attribution : attribution par source ; attribution par travaux historiques
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Benoit Jules Fils (promoteur)
Description
Commentaire descriptif : Le lotissement est orienté est-ouest et coupé dans la sens de sa longueur par l'avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny (ancienne avenue de Paris) qui est en fait le turcis levé au 18e siècle pour protéger les marais salants des grandes marées. Le lotissement est entouré à l'ouest et au nord par l'étier du Pouliguen (qui alimente les marais salants) et s'étire au nord-est par derrière le lotissement Pavie. Sa plage est longue et en pente très douce avec un sable d'une très fine granulométrie. Il faut parfois marcher 500 m à marée basse pour se baigner. L'artère principale, l'avenue des Lilas relie l'avenue parallèle à la plage du quartier Pavie jusqu'au pont du Pouliguen au bout du turcis.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : granite ; moellon ; enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise ; tuile mécanique
Typologie : Châlet ; médiéval ; classique ; anglo-normand ; basque ; breton ; provençal.
Etat de conservation : restauré
Intérêt de l'oeuvre
Oeuvre étudiée
|

|
| La raffinerie de sel vue du pont du Pouliguen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|